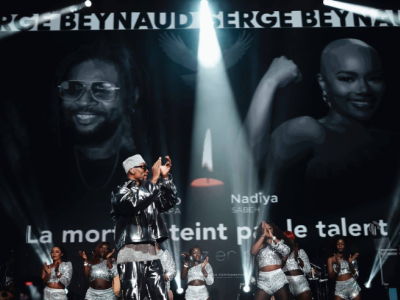Trafic de cocaïne: la Guyane et les Antilles, portes d entrée vers l Europe

Les saisies de poudre blanche sont en hausse en France. Une récente analyse de l Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) explique comment la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont devenues une zone de transit majeure dans ce trafic à destination du continent européen.
Record historique battu en 2015 : 11 tonnes de cocaïne saisies sur le territoire français selon les chiffres de l OCRTIS (ministère de l Intérieur) ; 17 même au total, si l on prend en compte les saisies réalisées par les douanes cette fois, en-dehors du territoire national, en partenariat avec les agences homologues, comme l Agence anti-drogue américaine (DEA). C est au large de la Martinique qu a eu lieu la plus grosse saisie de cocaïne en France : en avril 2015, 2,25 tonnes d une valeur de 70 millions d euros ont été trouvées à bord du voilier Silandra.
Ces chiffres ne sont pas nouveaux. Mais dans le dernier numéro de Drogues, enjeux internationaux, paru fin juillet, l OFDT les replace dans leurs contextes géographique et historique. « En l espace de quelques années, les Antilles françaises et la Guyane sont devenues des corridors très fréquentés par les trafiquants, une zone de trafic "intense", comme en témoigne l importance des saisies réalisées ces dernières années », écrivent les auteurs. Ces chiffres accrus trouvent plusieurs explications, conjoncturelles et structurelles. Les causes immédiates sont simples : une meilleure efficacité des services répressifs d un côté, et une intensification du trafic de l autre, font logiquement grimper les statistiques. En outre, « les plantations de coca en Colombie repartent à la hausse, et la DEA a prévenu que les flux se sont intensifiés », ajoute Michel Gandilhon, interrogé par RFI. Mais d autres phénomènes de fond viennent compléter le tableau. Le Venezuela déstabilisé
Dans les années 1970-1980, l essor du marché de la cocaïne sud-américaine se fait principalement en direction des métropoles américaines. Mais la géopolitique régionale a évolué, et les différents plans de lutte américains contre le narcotrafic (colombien et péruvien) comme l Air Bridge Denial Program (1995) ont quelque peu rebattu les cartes et ont enclenché « un effet ballon », explique Michel Gandilhon, c est-à-dire un « déplacement des trafics ». Les réseaux de trafiquants sont effectivement connus pour leur adaptabilité.
Ainsi, si le vaste marché étatsunien reste une cible de choix pour l export de la poudre blanche, les Antilles sont devenues un sas important pour alimenter le marché européen, depuis le milieu des années 1990, avec une forte hausse ces cinq dernières années. « La Guadeloupe et la Martinique deviennent de manière croissante, à l instar de la Jamaïque et de la République dominicaine, des États "entrepôts" où la cocaïne est stockée. Selon ONUDC, sur les 250 tonnes de cocaïne destinées au marché européen, 30 % transiteraient aujourd hui par les Antilles. La moitié de ces flux transiteraient directement vers l Europe, 20% passeraient par l Afrique de l Ouest », selon l OFDT. L explication de ce phénomène tient pour partie à l affaiblissement et à la déstabilisation sécuritaire que connaît l Etat vénézuélien, avant même la mort d Hugo Chavez en mars 2013. Avec une corruption endémique et un taux de criminalité parmi les plus élevés de la planète, le pays affermi comme un terreau propice aux trafiquants, notamment colombiens, qui délocalisent leurs laboratoires de l autre côté de leur frontière (lire le rapport de l OFDT à ce sujet). Avec ses quelque 2800 km de côtes, le Venezuela est par ailleurs un carrefour stratégique idéal pour arroser les îles caribéennes. Lesquelles, en plus d être une courroie de transmission, ont toujours été un marché de consommation locale de crack (cocaïne basée).
La Guyane voisine fait également les frais de cette modification du trafic de stupéfiants. La collectivité française est certes située en marge des grands axes caribéens, mais sa topographie (fluviale et forestière à 90%) ainsi que la porosité des longues frontières terrestres avec le Surinam et le Brésil sont des atouts supplémentaires pour les réseaux criminels. Les échanges en direction de l Europe ne datent pas d hier, mais ils se sont là encore accrus ces dernières années. Entre 2012 et 2014, les saisies en provenance de la Guyane ont augmenté de 64 %, passant de 86 à 141 kilogrammes.
 Le deuxième facteur explicatif tient à « la diversification énorme des vecteurs », indique Michel Gandilhon, autrement dit des moyens de transport.
Le deuxième facteur explicatif tient à « la diversification énorme des vecteurs », indique Michel Gandilhon, autrement dit des moyens de transport.
Le transport maritime en alternative aux voies aériennes
Dans les années 1970 et 1980, le transport aérien était privilégié par les trafiquants qui exportaient directement depuis le pays d origine. Aujourd hui, l avion reste un moyen de transport très emprunté, mais différemment. Les lignes commerciales sont utilisées pour acheminer la marchandise. Non par les trafiquants eux-mêmes, mais par des « mules », souvent des jeunes d origine modeste, appâtés par l espoir de recevoir plusieurs milliers d euros si le bagage arrive à bon port.
Ainsi, le service des douanes de l aéroport d Orly, à Paris, a saisi plus de 374 kilos de cocaïne en 2015, selon des chiffres révélés en mai dernier. Le directeur adjoint des douanes d Orly évoquait alors une « tendance lourde », concernant l import de poudre. « Les flux sont assez soutenus en présence des départements d outre-mer, la France est devenue un marché de prédilection. On a aussi davantage de mules qui transportent in corpore », i.e dans leurs vêtements voire sur ou même dans le corps. Le nombre d arrestations de « mules » est également éloquent : 100 en 2014, 159 en 2015, à Orly. A Roissy, l autre aéroport du nord de Paris, les saisies de l OCRTIS montrent que la Martinique et la Guyane sont les deux principaux départements de provenance de la cocaïne, derrière le Brésil.
Le trafic maritime s'est rendu complémentaire de l aérien à partir du milieu des années 1990. Des côtes vénézuéliennes vers les îles part tout type de bateau : go-fast (petits esquifs à moteur puissant), voilier de plaisance, yacht, bateau de pêche, et même des sous-marins qui sillonnent la mer des Caraïbes et les côtes d'Amérique centrale.
Le stock qui n est pas consommé localement est expédié par porte-conteneur. Emblème de la mondialisation, ces géants des mers transportent des dizaines de milliers de tonnes de marchandises. La poudre blanche peut être dissimulée partout, jusqu à l intérieur des cloisons. La « came » est comme une aiguille dans une botte de foin. Au départ comme à l arrivée, le coup de main de dockers locaux est souvent incontournable.
Les navires de commerce empruntent les autoroutes maritimes. Celle du nord en particulier. Elle part de Fort-de-France pour atteindre, via l archipel des Açores, trois grands ports européens : Rotterdam (Pays-Bas) principalement, Anvers (Belgique) mais aussi Le Havre (France) où, en 2014, la plus grosse saisie en France métropolitaine (1,4 tonne) y a été réalisée. Les ports espagnols et italiens ne sont pas en reste d approvisionnement régulier. En 2014, 4/5 de la cocaïne saisie sur le continent l était dans ces cinq pays. Les services de renseignements occidentaux estiment que 60% de la cocaïne qui arrive sur le port néerlandais de Rotterdam, l un des plus grands centres de distribution de stupéfiant d Europe, provient du Suriname et des « suri-cartels ». D'autres routes plus au sud mènent jusqu'en Afrique de l'Ouest, à la fois marché de consommation et « zone de rebond » vers les marchés européens (rapport de l'OFDT).