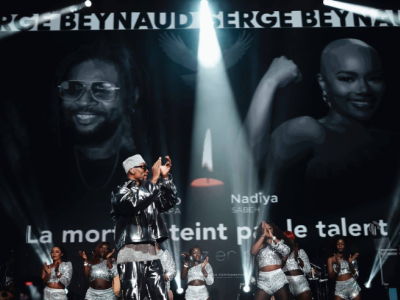Le Créole, héritage africain Ces mots provenant de toute l Afrique

Il nous a été appris que le créole venait majoritairement du français, mais il est logique qu une oreille qui ne comprend que le français ne puisse pas entendre l héritage Africain dans cette langue.
Afin que chaque créole ( Martinique, Guadeloupe, Guyane, Cap vert , Haiti ) puisse avoir accès à cet héritage, cet article sera en plusieurs parties. Cette première partie sera sur le créole Martiniquais et Guadeloupéen.
Premièrement, pour mieux comprendre quels sont les pays d Afrique concernés, revenons brièvement sur la répartition des esclaves.

Il y a 3 zones bien définies qui étaient à la fois les points de départ des esclaves mais aussi 3 Royaumes : Sénégal, Bénin (Sud du Nigéria, Bénin et Togo), Kongo (sud des 2 Congos, sud du Gabon et nord de l Angola). Ainsi, le R. P. Jean-Baptiste Du Tertre (1), nous dit ceci : les nègres sont tous originaires d Afrique, des côtes de Guinée, d Angola, du Sénégal ou du Cap-Vert . Le contact entre ces trois groupes qui ont des cultures et des langues différentes furent quotidienne aux Antilles.
Aujourd hui sur ce littoral Ouest de l Afrique, il y a plusieurs pays tels que : le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin, la Republique du congo, Republique Démocratique du Congo (ex Zaire), le Gabon, l Angola
Mais deux royaumes nous intéressent plus particulièrement, celui du Bénin et le Kongo. En effet, il a été prouvé que l apport de ces populations dans ces îles ont influencé leurs créoles tant et si bien que le Martiniquais (tout comme l Haitien) aurait plus une influence de L Ewe langue du Royaume du Bénin et le Guadeloupéen du Kikongo et du kibundu du Royaume Kongo.
L influence de ces langues africaines sont présentes en premier lieu dans la grammaire .
Quand nous regardons toutes les fondations de la langue, que ce soit la conjugaison, les marqueurs de temps, les pronoms, la syntaxe, la post-position des déterminants, des articles et même certains mots du vocabulaire crucial, on se rend compte de l héritage Africain. Ces captifs ont effectué une forme de résistance et d unité à travers la langue. Telle une boite noire.
GRAMMAIRE
Exemple :
En Manjaku (langue de Guinée) : Abuk U ( ton enfant) En créole martiniquais = Ych Ou (ton enfant)
En Wolof: Na nga def? : ça va? (litteralement: Comment tu fais?)
Créole martiniquais: Sa ou fè ? ( ça va?)
En Manjaku =man joo ka lemp ( j étais entrain de travailler) En créole Martinique = Man té ka travay ( j étais entrain de travailler)
En Lingala (langue Congo) = Mama na ngai= Ma mère (littéralement : Mère de moi)
En créole guadeloupéen = Manman an mwen = ma mère (litt: mère de moi)
Lingala = Na ko beta yo= je vais te frapper
En créole guadeloupéen= An ké bat ou = je vais te frapper
Lingala = Na keyi nairobi = je vais à Nairobi
créole guadeloupéen= An key Lapwent = Je vais à pointe à pitre.
Lingala = Ndako oyo = cette maison ( litt : Maison cette) créole guadeloupéen = Kaz lasa = cette maison ( litt: maison cette)
Le ka et le ké de la conjugaison créole viennent du Sénégal n gha et n ghé.
Pronoms personnels :
En créole : MARTINIQUAIS = Man (je) ; Ou/wou ( tu) ; i (il ; elle) Langues Africaines: Bassa Cameroun = Mè (je) ; Ou (tu); A (il/elle) Manjaku= Man (je) ; Ou (tu) ; A (il /elle) Swahili= Ni (je) ; Ou (tu) ; A (il/elle) Ga= Man (je) ; Wo (tu) ; i/e/yé ( il ou elle) Ewé = Me (je) ; Wo (tu); i/e/yé (il ou elle) Langue Sena = Kou (je) ; Ou (tu) ; i ( il /elle)
Yo: existe en lingala : YO et en Swahili: Yao
Comme dans la plupart des langues Africaines, le pronom personnel de la 3eme personne en créole Martiniquais ne fait pas la distinction entre le masculin et le féminin
Swahili : Mama yao ( leur mère) Martiniquais : Manman yo (leur mère) Guadeloupéen : Manman ayo ( leur mère)
Il y a donc une formulation et compréhension des phrases typiquement africaine. Les langues Martiniquaise , haïtienne et guadeloupéenne sont en accord avec la famille nigéro-congolaises. Pour preuve :
VOCABULAIRE
- le mot Zanba (personnage de conte) se retrouve au Congo Brazzaville et Congo Kinshasa N Zamba
- Bonda qui signifie derrière, fesses en Martinique et Guadeloupe se retrouve dans plusieurs langues africaines: Comparons avec plusieurs langues Africaines. ( les u se prononce ou )
Kikongo : Mbunda (derrière) ; Kimbundu : Mbunda (derrière , anus) Bambara : Boda ( anus) terme utilisé pour les insultes. Malinké : Bunda (même sens qu aux antilles) Mandingue : Buu-daa ( même sens) Djoula : Boda (fesses) Sango : Ngbònda : (derrière)
- Boula (dans une formation de gwo ka, ce sont les deux tambours couchés sur lesquels sont assis les joueurs de gwo ka : boulayè) se retrouve en Angola et dans les deux Congo. Langue kikongo : Mbula ; langue lingala : Bula.
- Ainsi Dendé (noix de palmier) se dit Ndende et Ondendi (huile de palme) respectivement en kikongo et en umbudu
- Soucougnan vient des mots Su ku gna ou Su gna ku qui veulent dire : payer pour la mort de quelqu un en Fongbe langue du Benin et du Nigeria. Il est appelé Soukhounia en Soninké ( langue du Mali).
- Le mot Kongolyo (guadeloupe/martinique) signifie mille-patte à son origine dans le kikongosous la forme de nkongolo
- le mot Gembo (Djembo ou Guimbo en guadeloupéen ): qui veut dire chauve-souris à le même sens en kikongo. D où la fameuse chanson de Carnaval : Guimbo la (pilipipip !) an zafè ay .
- Le mot Accra ( beignets de morue) est d origine africaine de la langue Ewe parlé au Bénin qui là bas désigne des beignets de légumes
- Le mot Béké signifie un blanc en créole mais plus precisément un blanc pays souvent ancêtre des blancs esclavagistes reconvertis dans l agro-alimentaire ou l import export et en Igbo langue du Nigeria désigne aussi un blanc
- Le mot Awa signifie oui en Soussou langue de la Guinée alors qu en créole il signifie non . awa = interjection de négation, de mécontentement, de désaccord kikongo : awa = interjection ou adverbe de négation kimbundu : awa = interjection pour exprimer l ennui ou le désaccord
- Tototo utilisé lorsque nous arrivons chez quelqu un est utilisé dans pratiquement toute l Afrique sous la forme Kokoko ( même signification)
- Yé kri Yé kra était utilisé chez les peuples du Congo dont les Lubas . Ce cri était lancé par le grio avant qu il raconte une histoire afin d avoir l attention de ses spéctateurs.
- Créole martiniquais : Sanm (ressembler à, être similaire à) Egypte nubienne : SAM (ressemblance, similitude) Wolof : Sâmandây (semblable à, similaire )
cf : Page 322 De Nation nègre et culture
- Dans les Caraïbes et dans l océan indien, Moun signifie Personne comparons avec les langues Africaines. (les u se prononcent ou ) kikongo= KiMUNtu (l humanité) Kikongo= MUNtu (personne) Bamoun = MUN (personne) kituba= MUNtu Lunganda =OMUNtu Luhya= OMUNdu kinyarwanda= UMUNtu Tshiluba = MUNtu Chichewa=MUNthu yao=wu-MUUNdu kwanyama= OMUNhu Shona= MUNhu Haoussa=MUTUN= (personne)
Signalons enfin qu en Baoulé (autre langue du groupe Akan) , la terminaison Mun est utilisée pour caractériser une catégorie humaine Exemple: Sran = Une personne. Sranmun = les gens. Bakanmun= les garçons.
En guadeloupéen :
TiMoun : les enfants ; GranMoun : Les Il y a même un suffixe : Moun en Guerzé (Libéria), qui s adjoint à un nom de localité , au sens de habitant de .
EX : Samoémoun : les gens de Samoé.
On peut comparer dans l ordre inverse avec le guadeloupéen : Moun Gozié (les habitants du Gosiers) par exemple.
- Aux Antilles, le mot Djok signifie Vigoureux , costaud, robuste . En éwé & Ga = Djoko (vigoureux) En éwé = Djou Djoku zi ( Se surpasser) Bassa Cameroun = Ndjok (éléphant)
- Aux Antilles, le mot Koko ou Kok (guadeloupe) désigne le sexe masculin . Il a donné le verbe koké signifiant avoir un rapport sexuel. Comparons avec les langues Africaines.
Langue Kikongo = Koko ( main, bras, patte de devant ; Mâle). Langue Yoruba = Oko ( sexe masculin) Langue Swahili = Koko ( testicules) Krio de sierria leone = Koko ( bosse sur le corps humain) langue Wolof = Koy ( sexe masculin)
- Aux Antilles, le mot Agoulou désigne un Vorace .
Rapprochement avec les langues Africaines:
En Haoussa = Agoulou ( Vautour) Lingala = Ngoulou ( goulument ) Kikongo = Ngoulou ( porc, cochon, vorace, sale) Kimbundu = goulou ( même sens que le kikongo) Kimbundu = Ngoulou (porc , indécent)
- Matoutou : nom du plat de crabes dégusté à Pâques (préparé au colombo, sorte de curry, vive la créolité ) En Fongbè :atoutou = mets à base de crabes mélangés à la farine de maïs . En Kikongo :matoutou = souris Matoutou-falaise désigne une mygale .
- Mabouya en kikongo: désigne une espèce de lézard albinos, jaune, avec des yeux rouges, réputé pour sortir la nuit et se coller à l hommes s il lui saute ; par extension, a désigné dans une certaine chanson de kompa haïtien la femme qui danse en remuant beaucoup son postérieur et en se collant au danseur ( Fanm ka dansé kon Mabouya ! )
- Ababa en créole signifie un sourd muet, un imbécile. En Kikongo, BABA signifie sourd muet.
- Kaya : feuille de cannabis. En Kikongo MAKAYA veut dire des feuilles.
- Malanga : un légume comestible appelé aussi CHOU CARAIBE. En Kikongo MALANGA, des tuberculoses comestibles.
- Tak-tak en créole: Espèce de poisson.En Kikongo NTAKATAKA un poisson.
- KI : Lequel. En Kikongo NKI veut dire QUEL, LEQUEL ?
- Ba : Pour, donner. En Kikongo BA, pour , donner.
- Gonbo : Un légume vert. En Kikongo NGOMBO, est aussi un légume vert.
- Malanga : Espèce d igname. En Kikongo MALANGA, igname.
- Foufoun : Organe sexuel féminin. En Kikongo FUNI/FUNU, organe sexuel féminin.
- Kokot : Vagin, clitoris.En Kikongo KOKODI, clitoris.
- Bobo : Plaie. En Kikongo BOOBO, plaie.
- Lota : Mycose. En Kikongo LOOTA, mycose, maladie de la peau.
COMPARAISON DES ONOMATOPEES
- Créole : PO Bruit de chute / Kikongo Poo bruit de chute
- Créole : To bruit d un coup sec / kikongo : to bruit d un coup sec
- Créole : ta bruit d un coup sec / Kikongo : ta bruit semblable à un coup de pistolet , une bouteille qu on ouvre. ect
- Créole Bo bruit de chute / kikongo Bwo bruit de chute
- Créole pok bruit d un coup sec / kikongo poka bruit d un coup de baton
- Créole : Blokoto bruit d un coup sec / kikongo : Bolokoto chute de quelque chose de dur .
- Créole : Kyous avaler d un coup / kikongo : kyu onomatopée désignant la déglutition .
- Créole : Chwa-Chwa bruit de la mer / Kikongo : chya-chya Onomatopée pour le bruit des vagues , le clapotage.
- Créole : Kya-kya-kya onomatopée pour le rire / kikongo : onomatopée pour le rire
Par ailleurs, le Tchip se retrouve dans toute les diasporas noirs , il est typique du continent africain , où sa durée de phonation est proportionnelle au degré de dédain qu une personne veut marquer pour une autre .
Tout ceci démontre que, contrairement à ce qu affirment certains linguistes, dans le but de donner au français le rôle exclusif dans la formation du créole, les Africains n ont pas oublié leurs langues en arrivant dans les colonies.
[g1_space value="20"]
[/g1_space]
[g1_space value="20"]
[/g1_space]